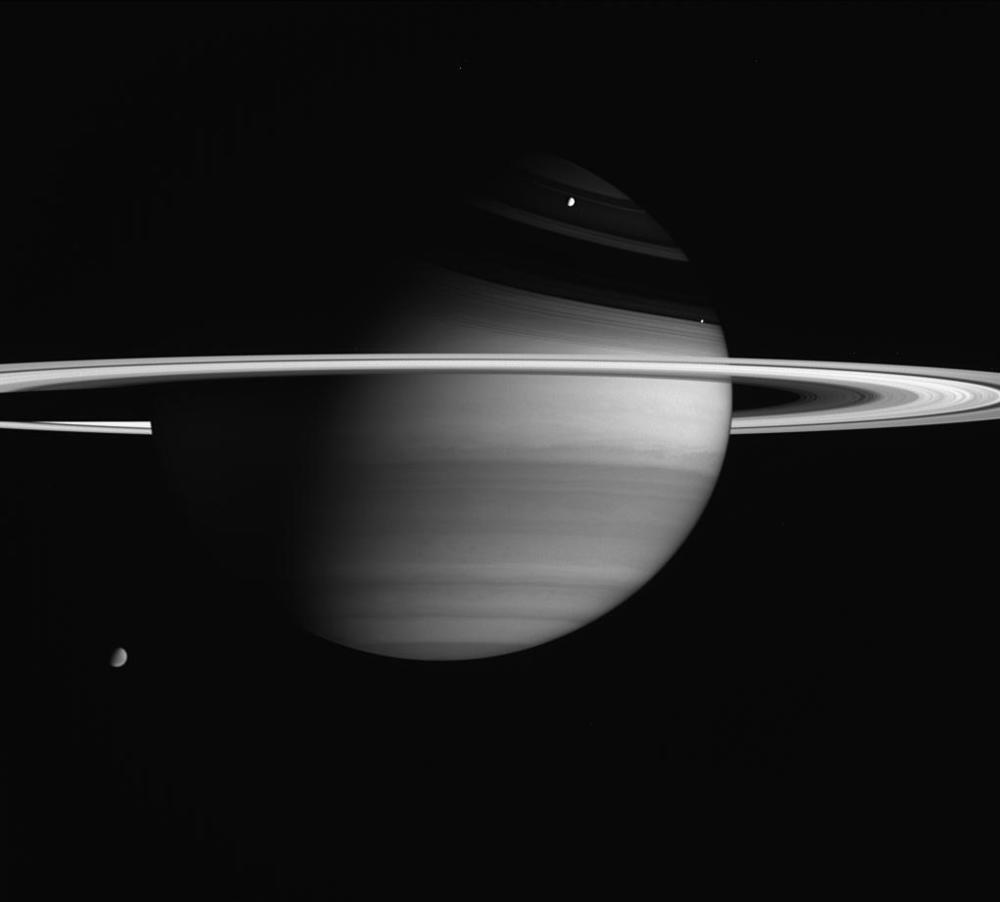Deux fusions de trous noirs, mesurée à un mois d'intervalle fin 2024 par la collaboration LIGO-Virgo-KAGRA, permet aux chercheurs de mieux comprendre la nature et l'évolution des collisions les plus violentes de l'univers. Les données recueillies lors de ces fusions valident également avec une précision sans précédent les lois fondamentales de la physique prédites par Albert Einstein et font progresser la recherche de nouvelles particules élémentaires encore inconnues, susceptibles d'extraire de l'énergie des trous noirs. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters.
LIGO-Virgo-KAGRA est un réseau mondial de détecteurs d'ondes gravitationnelles de pointe et mène actuellement sa quatrième campagne d'observation, O4. Cette campagne a débuté fin mai 2023 et devrait se poursuivre jusqu'à mi-novembre de cette année. À ce jour, environ 300 fusions de trous noirs ont été observées grâce aux ondes gravitationnelles depuis 2015, en comptant les candidats identifiés lors de la campagne O4 en cours. Ces dernières années, les chercheurs et les ingénieurs de LIGO ont apporté des améliorations importantes aux détecteurs, ce qui permet aujourd'hui des mesures précises des formes d'onde de fusion qui permettent le type d'observations subtiles qui étaient nécessaires ici. Une meilleure sensibilité permet non seulement à LIGO de détecter beaucoup plus de signaux, mais aussi de mieux comprendre ce qu'on détecte.
Dans cet article, la collaboration internationale rapporte la détection de deux événements d'ondes gravitationnelles datant d'octobre et novembre 2024. Les sources de ces deux signaux sont caractérisées par des rotations rapides du trou noir primaire (le plus massif du couple), mesurées avec précision, ainsi que par un désalignement spin-orbite non négligeable et des rapports de masse inégaux entre leurs trous noirs constitutifs. Ces propriétés sont caractéristiques des binaires dont l'objet le plus massif s'est lui-même formé par la fusion d'un précédent système binaire de trous noirs et suggèrent que les sources de GW241011 et GW241110 pourraient s'être formées dans des environnements stellaires denses où des fusions répétées peuvent avoir lieu. En tant que troisième événement d'ondes gravitationnelles le plus bruyant publié à ce jour, avec un rapport signal/bruit médian du réseau de 36,0, GW241011 fournit en outre des contraintes strictes sur la nature Kerr des trous noirs et la structure multipolaire de la génération d'ondes gravitationnelles.
La première fusion décrite dans cet article, GW241011 (11 octobre 2024), s'est produite à environ 700 millions d'années-lumière et résulte de la collision de deux trous noirs dont les masses sont respectivement d'environ 20 et 6 masses solaires. Et ce qui est remarquable, c'est que le plus massif des deux trous noirs à l'origine de GW241011 figure parmi les trous noirs à rotation la plus rapide jamais observés.
Près d'un mois plus tard, le signal d'ondes gravitationnelles GW241110 (10 novembre 2024) a été détecté à une distance d'environ 2,4 milliards d'années-lumière. Cet événement impliquait la fusion de trous noirs d'environ 17 et 8 masses solaires. Mais alors que la plupart des trous noirs détectés depuis 2015 tournent dans le même sens que leur orbite, ici, pour la première fois, le trou noir principal de GW241110 tournait dans le sens inverse de son orbite (rotation anti-parallèle à son vecteur de moment angulaire orbital). La rotation principale de la source de GW241011 est quant à elle inclinée d'environ 30° par rapport à l'axe de rotation de l'orbite, et le signal d'ondes gravitationnelles présente clairement une précession spin-orbite relativiste. Malgré cette différence de rotation, les sources de GW241011 et GW241110 possèdent des masses similaires entre 15 et 20 M⊙ environ, et les deux supposent des masses inégales pour leurs trous noirs constitutifs, GW241011 en particulier nécessitant un rapport de masse d'environ 3:1.
Des systèmes binaires de ce type avaient été prédits à partir d'observations antérieures, mais il s'agit de la première preuve directe de leur existence.
Ces deux fusions détectées suggèrent l'existence possible de trous noirs de « seconde génération ». En effet, chacun de ces événements présente un trou noir nettement plus massif que l’autre et en rotation rapide, ce qui constitue un indice de la formation de ces trous noirs issus de fusions antérieures. Ce processus, appelé fusion hiérarchique, suggère que ces systèmes se sont formés dans des environnements denses, dans des régions comme les amas d'étoiles, où les trous noirs sont plus susceptibles d'entrer en collision et de fusionner de manière répétée.
Grâce à sa détection très nette, GW241011 a pu être comparé aux prédictions de la théorie d'Einstein et à la solution du mathématicien Roy Kerr concernant la rotation des trous noirs (facteurs décrivant leur forme, leur rotation et d'autres propriétés). La rotation rapide du trou noir le déforme légèrement, laissant une signature caractéristique dans les ondes gravitationnelles qu'il émet. L'analyse de GW241011 a révélé une excellente concordance avec la solution de Kerr et a confirmé avec une précision sans précédent le rayonnement gravitationnel issu de moments multipolaires d'ordre supérieur.
La fusion de systèmes binaires de trous noirs produit des trous noirs résiduels en rotation rapide, avec des vitesses de rotation de l'ordre de χ ≈ 0,7 (valeur sans unité, la rotation maximale valant 1). L'émission asymétrique d'ondes gravitationnelles peut accélérer considérablement ces trous noirs résiduels, avec des vitesses pouvant atteindre des milliers de kilomètres par seconde. Mais dans des environnements où les vitesses de libération sont suffisamment élevées, les trous noirs résiduels peuvent toutefois rester liés gravitationnellement, capturer de nouveaux partenaires et participer à des fusions binaires ultérieures. C'est le scénario envisagé ici.
Les trous noirs en rotation rapide, tels que ceux observés dans cette étude, trouvent aussi une nouvelle application en physique des particules. Les astrophysiciens peuvent les utiliser pour tester l'existence et la masse de certaines particules élémentaires légères hypothétiques. Ces particules, appelées bosons ultralégers, sont prédites par des théories qui vont au-delà du Modèle Standard de la physique des particules. Si les bosons ultralégers existent, ils peuvent extraire de l'énergie de rotation des trous noirs. Dans ce cas, la quantité d'énergie extraite et le ralentissement de la rotation des trous noirs au fil du temps dépendent de la masse de ces particules, qui reste encore inconnue. Les chercheurs montrent que l'observation selon laquelle le trou noir massif du système binaire qui a émis GW241011 continue de tourner rapidement même des millions ou des milliards d'années après sa formation exclut une large gamme de masses de bosons ultralégers dans la gamme de masse 10-13 à 10-12 eV.
L'enrichissement des catalogues d'ondes gravitationnelles, qui a été rendu possible par le fonctionnement simultané d'observatoires d'ondes gravitationnelles de plus en plus sensibles, continue de révéler des sources individuellement intéressantes qui élargissent notre compréhension du paysage des binaires compactes. Les ondes gravitationnelles détectées lors de la quatrième campagne d'observation des observatoires LIGO, Virgo et KAGRA ont jusqu'à présent permis de tester de manière inédite la relativité et les modèles de formes d'onde gravitationnelles. Elles ont identifié des sources dans des régions nouvelles et inattendues de l'espace des paramètres. Les découvertes se poursuivront jusqu'à la fin de la quatrième campagne d'observation LIGO–Virgo–KAGRA, et au-delà...
Source
GW241011 and GW241110: Exploring Binary Formation and Fundamental Physics with Asymmetric, High-spin Black Hole Coalescences
LVK Collaboration
The Astrophysical Journal Letters, Volume 993, Number 1 (28 october 2025)
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae0d54
Illustration
Vue d'artiste d'une fusion de trous noirs asymétriques (Carl Knox, OzGrav, Swinburne University of Technology)



.jpg)